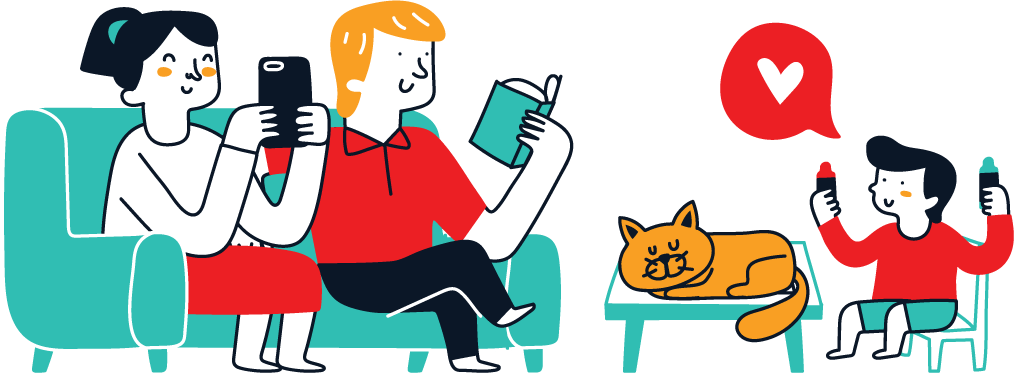À 77 ans, Didier savoure une retraite confortable après trois décennies passées dans une profession discrète mais prospère : celle d’huissier de justice. Cet ancien officier ministériel, installé à Paris, perçoit aujourd’hui une pension de 4 205 euros bruts mensuels, bien au-dessus de la moyenne nationale. Son parcours illustre les avantages financiers qu’offre encore ce métier, souvent délaissé par les jeunes générations. Derrière un statut austère et exigeant, il cache un solide potentiel de revenus et une sécurité à long terme.
À découvrir absolument :
- Retraite : qui touche 2 550 € de pension par mois en 2025?
- Comment je gagne 4 205 € par mois à la retraite à 77 ans grâce à un choix de carrière audacieux
- Retraite : je touche 1 605 €/mois, en n’ayant jamais travaillé ou presque grâce à l’allocation de solidarité aux personnes âgées
Une carrière prolongée dans un métier exigeant
Didier a consacré près de trente ans à sa fonction. Passionné, il n’a quitté son étude qu’à 65 ans, repoussant le départ pour profiter pleinement de son activité. « J’aimais profondément ce que je faisais. On m’a finalement suggéré de laisser la place aux jeunes », confie-t-il. En partant, il a bénéficié du taux plein, cumulé avec une retraite complémentaire bien garnie.
Son parcours professionnel s’est déroulé en deux temps : salarié dans un premier cabinet, puis travailleur libéral à la tête de sa propre étude.
Avant de raccrocher, il percevait environ 5 900 euros bruts mensuels, ce qui lui a permis d’investir dans l’immobilier. Aujourd’hui, il partage son temps entre sa maison parisienne et une vaste résidence secondaire en Sologne.
Des régimes de retraite spécifiques aux professions juridiques
Comme l’ensemble des officiers ministériels, Didier a cotisé à plusieurs caisses distinctes :
- La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) pour la retraite de base
- La Caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires pour la retraite complémentaire
Ces régimes fonctionnent selon un système à points. Chaque cotisation versée est convertie en points selon la valeur d’achat en vigueur, révisée chaque année. La pension finale dépend du nombre de points accumulés et de la valeur de service du point au moment du départ.
| Type de régime | Organisme gestionnaire | Mode de calcul | Valeur moyenne du point (2024) | Nature des cotisations |
|---|---|---|---|---|
| Retraite de base | CNAVPL | Système à points | 0,639 € | Proportionnelle au revenu professionnel |
| Retraite complémentaire | Caisse des officiers ministériels | Système à points | 1,30 € | Calculée selon la catégorie d’exercice |
| Invalidité-décès | Caisse complémentaire spécifique | Cotisation forfaitaire | N/A | Obligatoire pour les indépendants |
Grâce à ce double régime, les professions libérales peuvent prétendre à des retraites plus élevées, surtout après une longue carrière et un niveau de revenu soutenu.
Un métier à la fois rentable et délaissé
L’huissier de justice, devenu commissaire de justice depuis la réforme de 2022, bénéficie d’une rémunération attractive. Pourtant, la filière peine à séduire les nouveaux diplômés.
D’après la Chambre nationale des commissaires de justice, seuls 100 à 120 jeunes rejoignent la profession chaque année, alors que 150 à 180 seraient nécessaires pour assurer le renouvellement des études.
Cette désaffection s’explique par plusieurs éléments. La formation, longue et exigeante, décourage une partie des candidats. Le stage professionnel, indispensable à l’obtention du diplôme, demande un engagement important.
À cela s’ajoute le coût particulièrement élevé de l’installation, souvent supérieur à 200 000 euros, et une image persistante d’un métier autoritaire, jugé contraignant par le grand public.
Cette raréfaction inquiète les instances représentatives, alors que la demande en actes judiciaires, constats ou recouvrements demeure stable, voire en hausse.
Des écarts de pension marqués entre professions
Le cas de Didier illustre l’ampleur des disparités au sein du système français. En 2023, la pension moyenne des retraités atteignait 1 666 euros bruts par mois, soit environ 1 541 euros nets. Les anciens officiers publics, eux, peuvent toucher des montants deux à trois fois supérieurs, selon la durée d’activité et le niveau de revenus.
Selon l’Observatoire des inégalités, les 10 % de retraités les mieux lotis perçoivent 17 % de l’ensemble des pensions et les écarts de pension s’envolent jusqu’à 1 500 € par mois entre les différentes catégories socioprofessionnelles. Ces différences proviennent notamment de la structure des régimes spéciaux et des avantages liés à certaines professions indépendantes ou publiques.
Pour Didier, cette situation s’explique par un équilibre entre discipline, stabilité et stratégie d’épargne. « J’ai beaucoup travaillé, mais j’ai aussi su investir », résume-t-il. Un témoignage qui rappelle qu’un métier discret peut, à long terme, offrir une retraite plus que confortable.

Je m’intéresse aux questions économiques, à la vie des entreprises et aux enjeux liés à la retraite. À travers mes articles, je décrypte l’actualité du monde du travail et du patrimoine, avec l’objectif d’apporter des informations claires, pratiques et utiles à celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre les évolutions du système économique et leurs impacts sur leur quotidien.