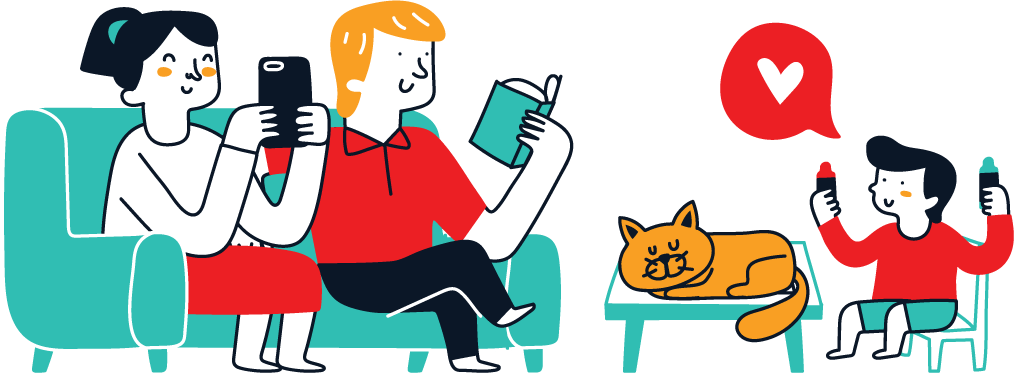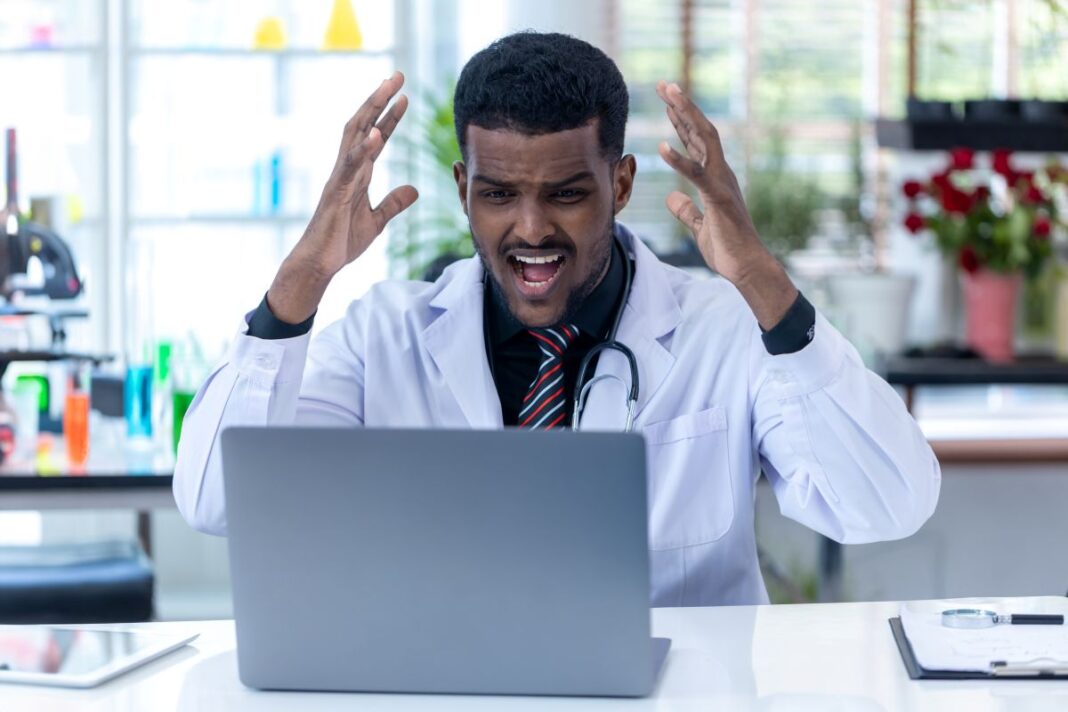Face à la progression constante du coût des arrêts de travail, l’exécutif a choisi d’agir par voie législative. Dans le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS 2026), le gouvernement entend restreindre la durée initiale des arrêts maladie. La mesure, qui fixe une limite de 15 jours pour les prescriptions en médecine de ville, provoque une levée de boucliers du corps médical. Les praticiens dénoncent une réforme qui ne tient pas compte de la réalité des pathologies ni des contraintes du système de soins. Le débat s’installe sur la pertinence d’une telle décision dans un contexte marqué par l’explosion des troubles psychiques et l’usure des conditions de travail. Décryptage.
À lire absolument :
- Arrêts maladie : contrairement aux idées reçues, les salariés français apparaissent plutôt …modérés
- Un nouveau formulaire Cerfa obligatoire pour stopper la fraude liée aux arrêts maladie : ce que vous devez savoir
- Arrêt maladie : 9 jours pour percevoir ses indemnités à partir de septembre! On vous en dis plus sur cette actualité (fausse)
Restreindre les arrêts maladie pour contenir la progression des indemnités journalières
Selon le rapport « Charges et produits » de la Caisse nationale d’assurance maladie, les dépenses liées aux arrêts de travail connaissent une dynamique préoccupante. Entre 2019 et 2023, elles ont crû de 6 % par an, contre 3 % sur la décennie précédente. En 2024, la facture s’est élevée à 11,3 milliards d’euros pour les salariés du secteur privé et les contractuels de la fonction publique.
Le gouvernement considère cette trajectoire comme « insoutenable » et avance plusieurs leviers pour reprendre la main sur les dépenses. Parmi eux, une disposition emblématique : limiter la durée initiale d’un arrêt prescrit en ville à 15 jours, et à 30 jours en cas d’hospitalisation.
Ces arrêts pourront être renouvelés par périodes de deux mois, mais uniquement si la justification médicale s’inscrit dans le cadre des recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS).
L’exécutif défend une approche fondée sur un suivi plus rapproché des patients, afin d’éviter les prescriptions longues sans réévaluation. Cette orientation s’accompagne d’une volonté de contenir la dépense par une baisse des indemnités journalières en arrêt maladie, présentée comme un levier pour rééquilibrer le financement de la Sécurité sociale.
Cette réforme s’insère dans un ensemble plus large qui comprend :
- La réduction du plafond d’indemnisation de 1,8 à 1,4 SMIC
- La suppression des affections de longue durée non exonérantes
- Et un renforcement de la lutte contre la fraude
Le gouvernement affirme que ces mesures permettront de responsabiliser les employeurs comme les salariés, tout en incitant les entreprises à investir davantage dans la prévention des risques professionnels.
Un seuil de 15 jours jugé irréaliste et contre-productif
Cette limitation est rejetée de manière quasi unanime par les médecins. Déjà en juillet, l’évocation de cette piste avait provoqué des réactions indignées. « Les recommandations de la HAS pour de nombreuses pathologies dépassent déjà trois semaines », soulignait alors le Dr Richard Talbot, de la Fédération des médecins de France.
Les syndicats de praticiens et de jeunes généralistes estiment que cette mesure générera des consultations inutiles, alors que les cabinets sont déjà saturés. Les exemples cités par la profession sont multiples :
- un patient opéré généralement revu après huit semaines
- une tendinite nécessitant un suivi de kinésithérapie impossible à débuter avant trois semaines
- un épisode dépressif exigeant plusieurs semaines d’arrêt et de traitement
Pour les médecins, cette règle ne ferait qu’augmenter la charge de travail et compliquer le suivi des patients, tout en fragilisant les plus vulnérables.
Les véritables ressorts de l’augmentation des indemnités journalières
Si le gouvernement met en avant la hausse des prescriptions, les données de la Cnam apportent un éclairage plus nuancé.
Entre 2019 et 2023, 60 % de l’augmentation des dépenses proviennent de facteurs démographiques et économiques : progression du salaire moyen, vieillissement de la population active et allongement des carrières. Les 40 % restants s’expliquent par une augmentation du taux de recours (34 %) et un allongement des arrêts (5 %).
| Facteurs | Part dans la hausse des dépenses d’IJ (2019-2023) |
|---|---|
| Hausse du salaire moyen et effets économiques | 60 % |
| Augmentation du taux de recours aux arrêts | 34 % |
| Allongement des durées d’arrêts | 5 % |
| Autres causes non identifiées | 1 % |
Les syndicats médicaux défendent une autre lecture : l’explosion des arrêts maladie traduirait d’abord une dégradation du monde du travail, marquée par l’intensification des troubles psychiques — burn-out, anxiété, dépression — et un accès aux soins souvent tardif.
Pour eux, la limitation des arrêts de travail à 15 jours ne résout aucune de ces fragilités structurelles. Au contraire, elle risque d’aggraver la désorganisation des soins et d’accentuer les tensions sociales autour de la santé au travail.

Je m’intéresse aux questions économiques, à la vie des entreprises et aux enjeux liés à la retraite. À travers mes articles, je décrypte l’actualité du monde du travail et du patrimoine, avec l’objectif d’apporter des informations claires, pratiques et utiles à celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre les évolutions du système économique et leurs impacts sur leur quotidien.