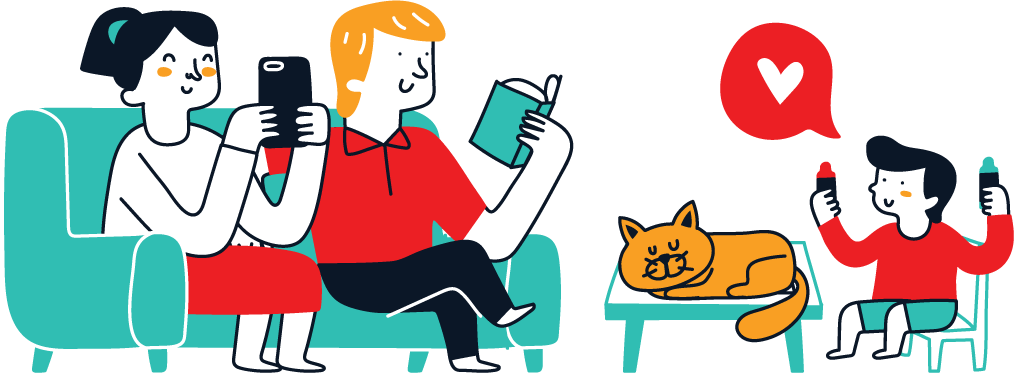Le dispositif de rupture conventionnelle, adopté en 2008, pourrait bientôt perdre une partie de sa souplesse. Le gouvernement envisage d’en réviser les modalités dès 2026, à travers le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Objectif : réduire le coût pour les finances publiques et limiter les usages jugés abusifs. Si la mesure ne supprime pas la possibilité de mettre fin à un CDI d’un commun accord, elle risque d’en transformer profondément l’équilibre économique. Alors, la rupture conventionnelle est-elle bientôt obsolète ?
À lire absolument :
- Etes-vous prêt pour une rupture conventionnelle ? 6 questions à vous poser avant d’entreprendre vos démarches
- Baisse d’indemnisation et conditions durcies : ce que la réforme du chômage vous réserve en 2026
- Allocations chômage : comment bénéficier d’une augmentation de ses indemnités chômage?
La rupture conventionnelle dans le collimateur de l’exécutif
D’après la Dares, plus de 514 000 ruptures conventionnelles ont été enregistrées en 2024, soit une progression de 20 % en cinq ans.
Ces départs représentent près d’un tiers des dépenses liées à l’assurance chômage, évaluées à 37 milliards d’euros, pour un coût estimé à 10 milliards d’euros pour la collectivité.
| Année | Nombre de ruptures conventionnelles | Évolution sur 5 ans | Coût estimé pour la collectivité | Part dans les dépenses chômage |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 428 000 | — | 8,3 milliards € | 28 % |
| 2022 | 490 000 | +14 % | 9,4 milliards € | 31 % |
| 2024 | 514 000 | +20 % | 10 milliards € | 33 % |
Face à cette inflation, le gouvernement souhaite alourdir la contribution patronale appliquée aux indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite. Le taux passerait de 30 % à 40 %, selon le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu affirme vouloir limiter les effets d’aubaine pour les entreprises, parfois accusées d’utiliser la rupture conventionnelle comme une démission déguisée. L’exécutif espère ainsi freiner certains comportements d’optimisation et générer jusqu’à 260 millions d’euros d’économies par an pour la Sécurité sociale.
Des conséquences encore floues pour les entreprises et les salariés
La hausse du taux de contribution pourrait modifier profondément les pratiques. Une rupture conventionnelle deviendrait parfois plus coûteuse qu’un licenciement économique ou individuel, poussant les employeurs à reconsidérer ce mode de séparation.
Les directions des ressources humaines devront revoir leurs stratégies et s’interroger sur l’intérêt réel d’un accord amiable. Dans ce nouveau contexte, la rupture conventionnelle risquerait de n’être retenue que dans des cas bien précis, où l’enjeu humain ou stratégique justifie le coût supplémentaire.
Pour mieux cerner les impacts possibles, plusieurs hypothèses se dessinent :
- Les entreprises pourraient privilégier des licenciements pour motif personnel, juridiquement plus encadrés mais moins onéreux
- Les salariés, découragés par des négociations plus difficiles, pourraient être poussés vers la démission, perdant ainsi l’accès à l’indemnisation chômage
- Le recours à des « licenciements arrangés », pratique courante avant 2008, pourrait réapparaître
Elle pourrait freiner les accords à l’amiable sans réduire les tensions. La rupture conventionnelle reste pourtant un outil de stabilité, qui prévient les contentieux et sécurise les parcours professionnels, évitant ainsi une erreur que beaucoup commettent en démissionnant : perdre leurs droits au chômage.
Si l’objectif officiel est de responsabiliser les employeurs, le risque existe que cette réforme entraîne une hausse des contentieux prud’homaux, les départs étant moins souvent encadrés par un accord commun.
Un dispositif appelé à se transformer, mais pas à disparaître
La rupture conventionnelle ne sera pas abolie en 2026. Elle restera un instrument légal du droit du travail, mais son usage sera plus sélectif. Les entreprises devront justifier plus rigoureusement chaque rupture, tant sur le plan économique que social.
Les services RH seront appelés à renforcer le dialogue social en amont, à anticiper les coûts et à formaliser davantage les dossiers. Dans un contexte budgétaire tendu, cette rigueur deviendra indispensable pour éviter les litiges.
Même alourdie financièrement, une rupture négociée et bien préparée continuera de représenter une solution plus sereine qu’un licenciement conflictuel. Mais sa mise en œuvre sera désormais l’affaire d’une véritable stratégie, où la concertation primera sur la facilité administrative.

Je m’intéresse aux questions économiques, à la vie des entreprises et aux enjeux liés à la retraite. À travers mes articles, je décrypte l’actualité du monde du travail et du patrimoine, avec l’objectif d’apporter des informations claires, pratiques et utiles à celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre les évolutions du système économique et leurs impacts sur leur quotidien.