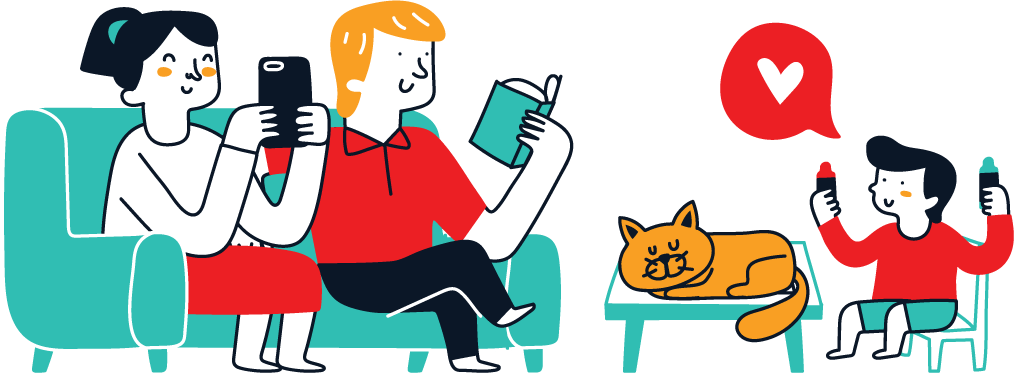Dans une France où les prix s’envolent, partir en vacances relève souvent d’un casse-tête financier. Si les congés payés assurent du temps libre, le budget nécessaire pour en profiter échappe à de nombreux salariés. Transport, hébergement, restauration, activités : chaque poste de dépense pèse lourd sur des revenus déjà entamés par les charges fixes. Le Smic suffit rarement à couvrir ces frais sans renoncer à d’autres besoins essentiels. Le départ en vacances devient alors un révélateur brutal des inégalités économiques. Voici les revenus nécessaires pour partir en vacances cet été.
Séjour prolongé ou escapade de courte durée ?
Le départ en vacances est loin d’être une évidence pour tous. Si certains ménages réservent chaque année leur séjour à l’avance, d’autres doivent composer avec des ressources trop limitées pour envisager autre chose qu’un week-end à proximité.
Malgré la légalité des congés payés, les revenus conditionnent de façon directe l’accès aux vacances.
Avec un Smic net d’environ 1 400 euros mensuels en 2025, une part importante des salariés doit choisir entre épargner au fil des mois ou renoncer. A titre informatif, le salaire médian en France s’élève à 2 183€ par mois.
Une location saisonnière, même modeste, impose des frais incompressibles. Cette situation touche particulièrement :
- les jeunes actifs, souvent contraints par des contrats précaires ou des débuts de carrière modestes
- les familles monoparentales, confrontées à un déséquilibre entre ressources et charges
Le poids économique du départ en vacances
Selon les données de l’Observatoire des inégalités, l’écart est flagrant entre les catégories de revenus lorsqu’il s’agit de partir loin de chez soi.
Les ménages les plus aisés ont nettement plus de facilité à quitter leur domicile pour les congés :
| Revenu mensuel net par personne | Part des personnes partant en vacances |
|---|---|
| Moins de 1 285 € | 42 % |
| Entre 1 285 € et 2 755 € | 60 % |
| Plus de 2 755 € | 76 % |
Le seuil de confort se situe autour de 2 800 euros mensuels, ce qui représente environ le double du Smic.
À partir de ce niveau, les congés deviennent plus fréquents et moins contraints budgétairement. Les cadres, professions intermédiaires et salariés du secteur privé bénéficiant de primes ou d’un treizième mois figurent parmi ceux qui voyagent le plus régulièrement.
Le coût moyen d’un départ
Pour envisager un départ d’une semaine en France, un salarié seul doit composer avec un ensemble de frais incompressibles :
- Transport : entre 100 et 300 euros selon la distance
- Hébergement : de 400 à 700 euros pour une location basique
- Repas et courses : entre 200 et 400 euros
- Loisirs : environ 100 à 200 euros
Soit un total avoisinant 850 à 1 600 euros pour un séjour classique, hors imprévus ou surcoûts. Multipliez cette estimation par deux ou trois pour une famille avec enfants, et la facture devient difficilement supportable sans anticipation.
Revenu disponible et arbitrages familiaux
Le niveau de revenu brut ne suffit pas à expliquer les disparités. Ce sont les charges fixes (logement, alimentation, transport, remboursements) qui déterminent le reste à vivre, soit le montant effectivement mobilisable pour les loisirs.
Un salarié vivant seul avec 2 000 euros peut disposer d’une marge supérieure à celle d’un couple avec enfants à revenus équivalents.
En zone urbaine tendue, où les loyers absorbent une grande part des ressources, la capacité à s’offrir des vacances dépend d’abord du budget résiduel.
Les arbitrages sont nombreux : certains préfèrent reporter leurs projets à la basse saison, d’autres organisent des départs plus courts ou s’orientent vers le tourisme rural, moins onéreux.
Une inégalité persistante devant les congés
Malgré l’existence de dispositifs comme ceux de l’Agence nationale pour les chèques vacances ou des aides ponctuelles via la CAF, le départ en vacances reste un privilège socialement segmenté.
L’écart entre ceux qui partent et ceux qui restent s’est creusé au fil des années.