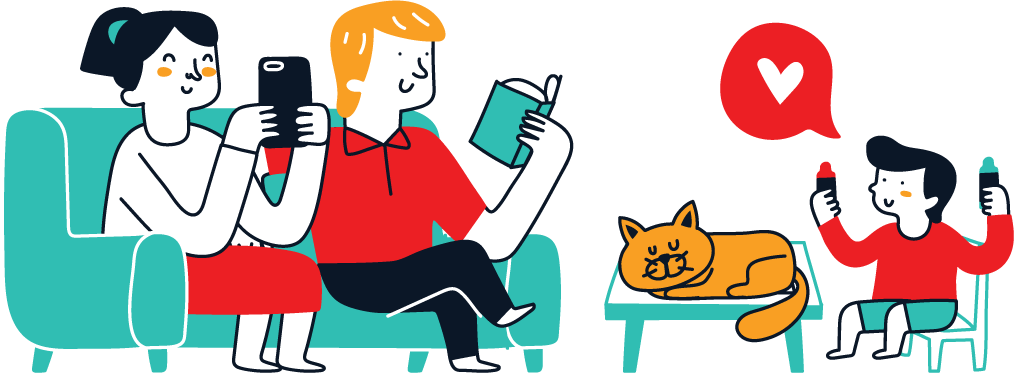Les Pays-Bas viennent d’être désignés comme le pays offrant le système de retraite le plus robuste au monde. Le cabinet Mercer, qui publie chaque année son étude comparative, a évalué 52 régimes selon leur niveau de prestations et leur solidité financière. Le constat est sans appel : le modèle néerlandais allie pensions confortables et équilibre budgétaire, quand la France, malgré un bon niveau de remplacement, peine à garantir la pérennité de son dispositif par répartition. Alors que Paris s’apprête à rouvrir le dossier sensible d’une nouvelle réforme, le regard se tourne vers Amsterdam pour comprendre ce mécanisme si particulier. Voici comment fonctionne le meilleur système de retraite au monde.
À découvrir absolument :
- Vous n’avez jamais eu d’emploi ? Vos droits insoupçonnés à la retraite en 2025
- Augmentation de l’âge de la retraite à 66,5 ans par le COR : le rapport qui fait polémique
- Combien mettre de côté pour une retraite dorée? Le calcul qui fait toute la différence
Une architecture en trois piliers
En résumé :
Le système néerlandais s’organise autour de trois niveaux complémentaires, qui assurent une couverture à la fois universelle et diversifiée.
- La pension publique de base, appelée AOW, constitue le premier socle. Versée à partir de 67 ans, elle est attribuée à toute personne ayant résidé et cotisé dans le pays. Son montant avoisine 1 350 euros mensuels pour une personne seule, ce qui permet de maintenir un niveau de vie minimal
- La retraite professionnelle, véritable moteur du dispositif. Alimentée conjointement par les employeurs et les salariés, cette épargne collective est investie sur les marchés financiers par des fonds de pension. Ces institutions disposent aujourd’hui de réserves colossales : près de 1 500 milliards d’euros en 2023, soit deux fois le produit intérieur brut national
- L’épargne individuelle, laissée à la discrétion des citoyens les plus prévoyants, qui souhaitent compléter leur pension par un effort personnel
Cette combinaison crée un système hybride, où la solidarité nationale se conjugue avec une capitalisation prudente et encadrée.
Les différences majeures avec le modèle français
La singularité néerlandaise se mesure surtout en comparaison avec la France. L’Hexagone a fait le choix quasi exclusif de la répartition : les cotisations des actifs financent directement les pensions des retraités. Mais le déséquilibre démographique complique cet agencement, entraînant des ajustements fréquents sur l’âge légal ou la durée de cotisation.
Aux Pays-Bas, l’approche est différente. Le pays articule solidarité publique et capitalisation collective. Les fonds sont gérés par des spécialistes sous contrôle des partenaires sociaux et des autorités publiques, avec une grande transparence des règles.
La confiance joue un rôle déterminant : les Néerlandais acceptent que le système s’adapte aux performances financières, plutôt que de garantir un droit intangible et figé. Cette flexibilité rend la mécanique plus résiliente et renforce son acceptabilité sociale.
| Pays | Taux de remplacement moyen | Niveau de pension publique de base | Importance de la capitalisation | Réserves financières (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Pays-Bas | 93,2 % du revenu antérieur | ~1 350 € par mois (AOW) | Très élevée (fonds de pension) | 1 500 milliards € (≈ 200 % PIB) |
| France | 70,1 % du revenu antérieur | Variable selon la carrière | Faible (capitalisation marginale) | Quasi inexistantes (répartition) |
En France, la réalité d’un salaire à 1 800 € à la retraite illustre ce taux de remplacement moyen limité à 70,1 %, bien en dessous du niveau garanti aux Pays-Bas.
La France pourrait-elle suivre cette voie ?
Importer un tel modèle en France impliquerait une profonde transformation culturelle. La capitalisation y est souvent perçue comme risquée, synonyme de spéculation ou d’inégalités. À l’inverse, aux Pays-Bas, elle est associée à stabilité et confiance grâce à une gouvernance stricte et collective.
Le système batave démontre qu’il est possible d’obtenir un haut niveau de pension tout en préservant la soutenabilité financière. Mais transposer cette organisation supposerait de redéfinir le rôle de l’État, de partager davantage la responsabilité entre les acteurs sociaux et de bâtir une confiance durable autour de la gestion de l’épargne.
La France, marquée par une longue tradition de réformes paramétriques successives, s’oriente pour l’instant vers l’ajustement plutôt que vers une refonte structurelle. Les exemples étrangers, et en particulier celui des Pays-Bas, nourrissent néanmoins le débat national à un moment où la question de l’équilibre financier des retraites revient au premier plan.

Je m’intéresse aux questions économiques, à la vie des entreprises et aux enjeux liés à la retraite. À travers mes articles, je décrypte l’actualité du monde du travail et du patrimoine, avec l’objectif d’apporter des informations claires, pratiques et utiles à celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre les évolutions du système économique et leurs impacts sur leur quotidien.