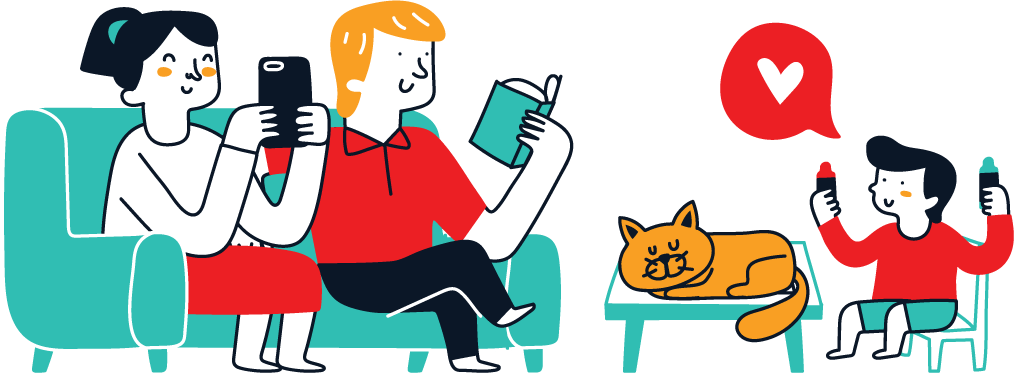À partir du 1er janvier 2026, la pension de réversion changera de visage. Ce dispositif, longtemps jugé inégalitaire et obscur, fera l’objet d’une refonte complète qui pourrait affecter directement les droits de plusieurs millions de retraités. Taux unique, accès élargi aux couples non mariés, méthode de calcul révisée : le gouvernement entend rendre le système plus cohérent, mais certains profils pourraient en ressortir lésés. Des arbitrages personnels, comme se marier ou réorganiser ses ressources, deviendront déterminants. Le calendrier s’accélère, et les futurs veufs et veuves doivent dès maintenant se préparer à ce basculement. Voici ce que va changer le nouveau taux pour les pensions de réversion en 2026.
Un taux harmonisé : des impacts divergents selon les assurés
Le projet de réforme prévoit l’introduction d’un taux unique de réversion, compris entre 50 % et 60 %, qui remplacera les règles actuelles propres à chaque régime.
Aujourd’hui, le régime général applique un taux de 54 %, tandis que les régimes complémentaires, comme Agirc-Arrco, retiennent 60 %. Le nouveau calcul de la pension de réversion vise à unifier ces pratiques.
Prenons l’exemple d’une veuve qui perçoit actuellement 1 080 € au titre d’une réversion calculée sur 54 % de la retraite de son conjoint.
Si le taux venait à descendre à 50 %, sa pension mensuelle chuterait à 1 000 €, entraînant une perte de 80 € par mois.
À l’échelle d’une année, l’écart devient significatif, surtout pour les retraités aux ressources limitées.
Le taux exact sera arrêté d’ici à la fin 2025. D’ici là, les arbitrages porteront sur un compromis entre rationalisation budgétaire et équité contributive.
Des conditions d’attribution repensées : vers une reconnaissance partielle des couples non mariés
Jusqu’à présent, seuls les conjoints mariés peuvent prétendre à une pension de réversion, à condition d’avoir atteint un âge minimum, souvent fixé à 55 ans, et de respecter des plafonds de ressources dans le privé.
PACS et concubinage en sont exclus.
La réforme envisage d’ouvrir partiellement ce droit à d’autres formes d’union, sous conditions précises. Il s’agira notamment de prouver :
- Une durée de vie commune suffisante
- Une dépendance économique vis-à-vis du conjoint décédé
Un couple pacsé depuis plusieurs années, avec des ressources partagées et une cohabitation durable, pourrait désormais entrer dans le champ des bénéficiaires.
Cela représenterait un tournant juridique pour les unions non matrimoniales, tout en posant des exigences documentaires fortes : déclarations fiscales, attestations de domicile commun, preuves de soutien financier.
Une formule de calcul remodelée : vers une approche plus proportionnelle
Aujourd’hui, la réversion est exclusivement calculée sur les droits du défunt, sans considération des ressources du conjoint survivant.
Cette logique pourrait être abandonnée au profit d’un modèle tenant compte des revenus du couple ou de la durée de l’union.
Exemple : le retraité touche 2 000 € de retraite et son épouse, 1 000 €. Dans le cadre du nouveau dispositif, la pension pourrait être établie sur la base des 2/3 de la pension de Mr, auxquels on soustrairait 1/3 de celle de Mme, soit environ 1 000 € mensuels.
Ce modèle favoriserait une redistribution plus fine, mais poserait problème pour les unions courtes ou les conjoints disposant de faibles droits propres :
| Situation familiale et financière | Pension du conjoint décédé | Retraite personnelle du survivant | Pension actuelle (54 %) | Hypothèse à 50 % | Nouveau calcul estimé (2/3 – 1/3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariage ancien (30 ans), faible retraite personnelle | 2 000 € | 1 000 € | 1 080 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Mariage récent (5 ans), revenus faibles | 1 500 € | 500 € | 810 € | 750 € | 750 € |
| Couple pacsé depuis 10 ans | 2 000 € | 1 200 € | Inéligible | Éligible potentiellement (1 000 €) | 800 € |
| Concubinage sans preuve de vie commune | 1 800 € | 0 € | Inéligible | Inéligible | Inéligible |