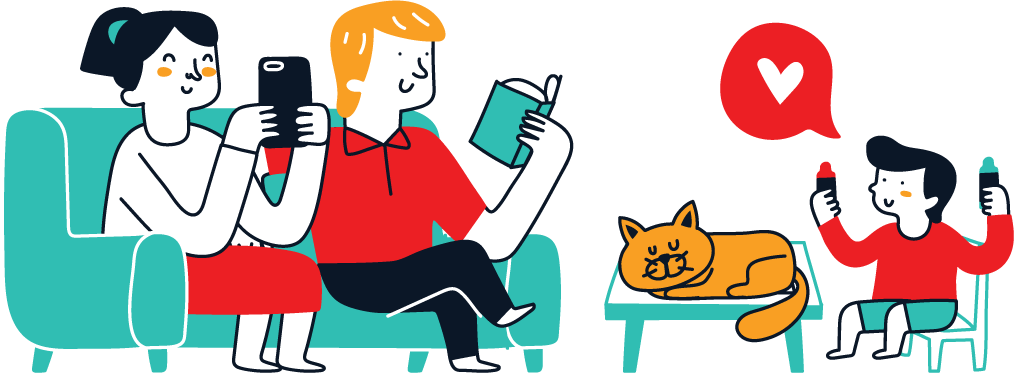Au-delà des congés payés, piliers du droit du travail, les salariés disposent en France d’un ensemble de dispositifs permettant de s’absenter temporairement pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles. Ces congés spéciaux, instaurés pour répondre à la diversité des situations humaines et sociales, visent à garantir une meilleure articulation entre vie privée et activité professionnelle. Encadrés par le Code du travail, ils peuvent être complétés ou améliorés par des conventions collectives selon les secteurs d’activité. Alors, comment fonctionnent les congés spéciaux ?
Le cadre général des congés spéciaux
Les congés spéciaux ou congés exceptionnels constituent des absences justifiées, accordées à tout salarié confronté à un événement particulier ou engagé dans un projet spécifique.
Ils s’appliquent à différentes situations : naissance d’un enfant, maladie d’un proche, formation, création d’entreprise ou simple besoin de pause professionnelle. Ces dispositifs, distincts des congés payés classiques, peuvent être rémunérés ou non selon leur nature et selon les accords internes à chaque entreprise.
Ils se regroupent en quatre grandes catégories :
- Les congés pour motifs familiaux
- Les congés à finalité professionnelle
- Les congés personnels
- Les absences liées à une mission civique ou sociale
Dans la plupart des cas, la demande de congé doit être adressée à l’employeur dans un délai précis. Ce dernier dispose d’un droit de regard, limité par la loi, afin d’assurer la continuité du service tout en respectant les droits du salarié.
Les congés spéciaux à caractère familial
Certains événements de la vie ouvrent droit à des absences spécifiques, rémunérées ou non selon les cas. Leur durée peut être prolongée si la convention collective de l’entreprise prévoit des conditions plus favorables. Ces congés permettent de concilier obligations familiales et engagement professionnel sans rompre le contrat de travail.
Parmi les principaux congés familiaux figurent :
- Le congé pour mariage ou PACS : quatre jours rémunérés sont accordés au salarié lors de son union, qu’il s’agisse d’un mariage ou d’un pacte civil de solidarité
- Le congé pour naissance ou adoption : trois jours ouvrables sont octroyés à l’occasion de l’arrivée d’un enfant. Ce congé peut se cumuler avec le congé paternité, mais non avec le congé maternité
- Le congé parental d’éducation : accessible après un an d’ancienneté, il permet de suspendre ou réduire son activité afin de s’occuper de son enfant. Il dure un an, renouvelable jusqu’à trois ans pour un enfant unique, et jusqu’à l’entrée en maternelle en cas de naissances multiples
- Le congé pour enfant malade : il autorise jusqu’à trois jours d’absence par an, ou cinq pour les familles nombreuses ou lorsque l’enfant a moins d’un an. Non rémunéré sauf disposition conventionnelle contraire, il doit être justifié par un certificat médical
- Les absences pour examens médicaux liés à la grossesse : la salariée enceinte bénéficie d’autorisations d’absence pour ses examens médicaux obligatoires. Son conjoint ou partenaire pacsé dispose de trois autorisations pour l’accompagner
- Le congé de solidarité familiale : destiné à accompagner un proche gravement malade ou en fin de vie, il peut durer trois mois renouvelables. Ce congé n’est pas rémunéré, mais le salarié peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement
- Le congé pour décès : la durée varie selon le lien de parenté — cinq jours pour la perte d’un enfant, trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire de PACS, d’un parent, d’un beau-parent ou d’un frère ou d’une sœur
Ces dispositifs traduisent la volonté du législateur de protéger les liens familiaux et de permettre à chacun de faire face à des situations personnelles sans compromettre son emploi.
Certains accords d’entreprise ou de branche peuvent également instaurer des dispositions plus avantageuses, comme un congé de naissance payé à 70 %, afin d’améliorer la prise en charge financière des salariés lors de ces événements familiaux.
Les congés spéciaux à dimension professionnelle
Le droit du travail reconnaît également la possibilité pour un salarié de s’absenter afin de mener un projet professionnel, de suivre une formation ou d’expérimenter un nouveau parcours. Ces congés favorisent la mobilité interne et externe, tout en sécurisant la carrière du salarié.
Le congé pour création ou reprise d’entreprise, accessible après deux ans d’ancienneté, permet au salarié de consacrer une période déterminée à la mise en œuvre d’un projet entrepreneurial.
La demande doit être formulée au moins deux mois à l’avance. L’employeur peut l’accepter, la refuser pour motif légitime ou la reporter jusqu’à six mois.
En l’absence de réponse dans les trente jours, la demande est réputée acceptée. Ce congé n’est pas rémunéré, mais le salarié conserve la possibilité de réintégrer son poste à son retour.
Le congé de transition professionnelle, ancien congé individuel de formation, s’adresse aux salariés souhaitant se reconvertir. Il nécessite deux ans d’ancienneté et s’applique aux formations longues, d’au moins six mois.
L’entreprise peut différer la demande pour assurer la continuité du service, mais un refus non motivé serait considéré comme abusif. Ce congé offre la possibilité de repenser sa trajectoire sans rompre son contrat de travail.
Les congés spéciaux à visée personnelle
Certains salariés choisissent de s’accorder une parenthèse dans leur carrière pour se ressourcer, voyager, ou mener un projet personnel. La loi encadre deux types d’absence répondant à cette logique.
Le congé sabbatique permet à un salarié disposant de six années d’expérience professionnelle, dont trois dans l’entreprise actuelle, de s’absenter entre six et onze mois. Il n’est pas rémunéré et ne peut être cumulé avec un congé pour création d’entreprise ou un congé de formation pris dans les six années précédentes.
L’employeur peut reporter la demande, mais l’absence de réponse dans les trente jours vaut accord.
Le congé sans solde, quant à lui, ne figure pas dans le Code du travail. Il repose sur un accord direct entre le salarié et l’employeur, qui en fixe la durée et les modalités. Non rémunéré, il peut être compensé par un compte épargne-temps, offrant ainsi une solution souple pour ceux qui souhaitent s’absenter temporairement.

Je m’intéresse aux questions économiques, à la vie des entreprises et aux enjeux liés à la retraite. À travers mes articles, je décrypte l’actualité du monde du travail et du patrimoine, avec l’objectif d’apporter des informations claires, pratiques et utiles à celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre les évolutions du système économique et leurs impacts sur leur quotidien.