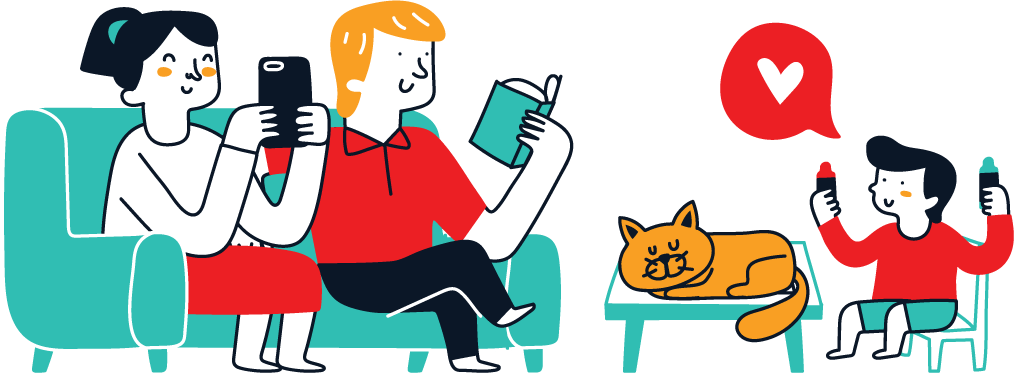Dès la fin mai, une règle peu connue mais scrupuleusement appliquée du droit du travail refait surface : les congés payés acquis entre juin 2023 et mai 2024 doivent être consommés avant le 31 mai 2025, sous peine de disparition pure et simple. Ce délai, fixé par la période de référence légale, ne souffre d’exception que dans quelques cas bien précis. Les salariés du privé, souvent pris de court par cette échéance, peuvent être sommés par leur employeur de solder leurs jours restants. Cette injonction, bien qu’encadrée, s’inscrit dans un cadre juridique clair que chacun gagnerait à connaître pour ne pas perdre ce qui lui revient. Tour d’horizon des droits, obligations et marges de négociation à disposition concernant les congés payés à prendre avant le 31 mai.
Des jours de repos qui peuvent expirer
Selon le Code du travail, chaque salarié cumule 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 30 jours par an.
Ces jours doivent être utilisés pendant une période précise appelée « période de référence ». Par défaut, celle-ci s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Ainsi, les congés générés entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 doivent être pris avant le 31 mai 2025.
Une fois cette date dépassée, si vous vous demandez si les congés payés peuvent être pris après le 31 mai, sachez qu’ils sont purement et simplement perdus, sauf dérogation prévue par un accord collectif ou cas de force majeure.
La prescription n’est ni théorique ni rare : de nombreux salariés voient ainsi disparaître des jours de repos faute d’anticipation.
Le rappel des ressources humaines en mai n’est donc pas une formalité, mais une application stricte de la règle.
Négocier un report ou adapter le calendrier
Toutes les entreprises n’appliquent pas nécessairement la même période de référence. Certaines branches disposent d’un calendrier conventionnel dérogatoire.
C’est notamment le cas :
- du BTP, dont la période va du 1er avril au 31 mars
- du spectacle vivant, encadré par Audiens
- de quelques conventions collectives fixant la période du 1er janvier au 31 décembre
Il est donc indispensable de consulter son accord d’entreprise ou sa convention collective avant de s’alarmer d’une échéance imminente.
En l’absence de régime particulier, un report des congés est envisageable mais ne peut jamais être décidé unilatéralement. Il suppose un accord exprès de l’employeur.
À l’inverse, l’entreprise ne peut imposer un report sans l’accord du salarié. Ce double consentement est une règle de base, confirmée par le site service-public.fr.
Certains salariés peuvent aussi mobiliser un compte épargne-temps (CET), s’ils en disposent, pour y transférer les congés non utilisés.
Cette faculté, ouverte à environ 8,6 % des salariés en France, permet une gestion à plus long terme.
Les situations où le report s’impose
Certaines circonstances empêchent la prise de congés dans les temps et donnent lieu à un report automatique :
- arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle
- congé maternité, paternité ou adoption
- impossibilité de poser ses jours à la demande de l’employeur pour raisons organisationnelles
Formaliser une demande ou faire valoir son droit
En dehors des cas où le report s’impose de plein droit, toute prolongation de la période d’utilisation des congés nécessite un accord clair avec l’employeur.
Pour cela, le salarié doit adresser une demande écrite, idéalement remise en main propre contre décharge ou envoyée en recommandé avec accusé de réception.
Cette demande doit préciser le nombre de jours concernés, la raison pour laquelle ils n’ont pas été posés dans les délais ainsi que, le cas échéant, la volonté de les transférer sur un compte épargne-temps.