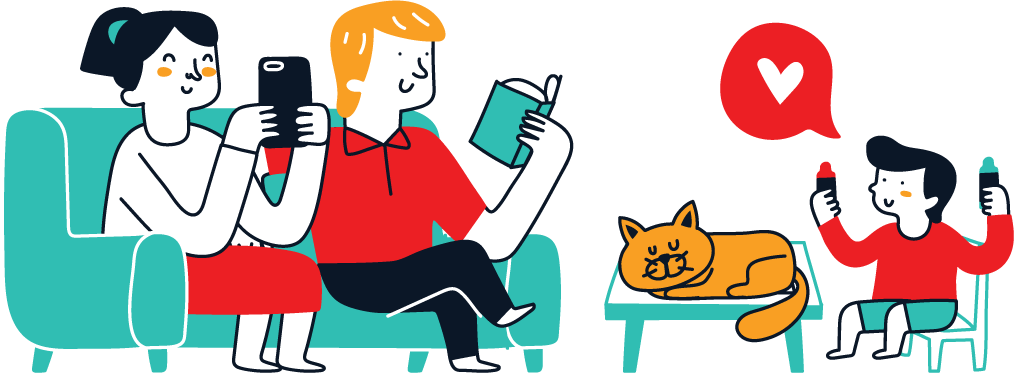Institué par la loi Mathys en 2014, le don de congés permet à un salarié de céder anonymement certains jours de repos à un collègue confronté à une situation personnelle exigeant une présence accrue auprès d’un proche. Pensé au départ pour les parents d’enfants gravement malades, le dispositif a été élargi aux aidants familiaux et, depuis 2020, aux salariés endeuillés. La mesure repose sur le volontariat et offre un cadre légal précis à une pratique solidaire, encadrée par le Code du travail. Le salarié bénéficiaire conserve sa rémunération, son ancienneté et ses droits sociaux. Voici toutes les modalités pour donner des congés en 5 étapes.
Conditions d’accès pour le salarié bénéficiaire
Le salarié recevant les jours de repos doit appartenir à la même entreprise que le donateur. Le régime concerne aussi bien les salariés du secteur privé que les agents publics (fonction publique d’État, territoriale, hospitalière) et les militaires.
Le bénéfice du don est ouvert lorsqu’un salarié est parent d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie grave, d’un handicap lourd ou victime d’un accident nécessitant une attention constante.
Il peut également en bénéficier s’il est proche aidant d’une personne en situation de handicap avec un taux d’incapacité permanent supérieur ou égal à 80 %, ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Le lien avec la personne aidée peut être conjugal, familial jusqu’au quatrième degré, ou fondé sur une cohabitation ou une aide régulière attestée.
Depuis la loi du 8 juin 2020, le dispositif inclut également les salariés confrontés au décès d’un enfant ou d’un jeune de moins de 25 ans à charge.
Attention, une erreur courante avec les congés payés qu’il faut absolument éviter est de ne pas les prendre avant la date butoir qui est en général fin avril.
Profil du salarié donateur
Tout salarié, quel que soit son contrat (CDI, CDD, temps partiel), peut effectuer un don de congés. L’acte repose sur une démarche volontaire, désintéressée et, par défaut, anonyme.
Il n’ouvre droit à aucune contrepartie : l’entreprise garde la possibilité de refuser un don, sans obligation de motivation.
Nature des congés pouvant être cédés
La législation européenne garantit à chaque salarié 24 jours ouvrables de congés payés annuels, soit quatre semaines : ces jours sont indisponibles pour le don.
Seuls les jours au-delà de ce seuil peuvent être transférés, parmi lesquels :
- Les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés
- Les jours de réduction du temps de travail (RTT)
- Les jours de récupération obtenus après des heures supplémentaires
- Les jours placés sur un Compte Épargne Temps
- Les jours de repos supplémentaires accordés par l’employeur
Un salarié ne peut pas céder des jours non encore acquis, ni faire don de jours prévisionnels.
Mettre en place un don de congés : les 5 étapes à respecter
L’organisation d’un don suit une procédure précise. Voici les cinq étapes à observer :
- Détection du besoin : le salarié informe son employeur de sa situation familiale nécessitant du temps supplémentaire
- Transmission des justificatifs : il fournit les documents médicaux ou administratifs attestant de la situation
- Lancement de l’appel à volontaires : l’entreprise informe les salariés, dans le respect de la confidentialité, qu’un don est possible
- Formalisation des dons : les volontaires remplissent un formulaire précisant le type et le nombre de jours cédés
- Validation par l’employeur : après contrôle, les jours sont déduits des compteurs des donateurs et ajoutés à celui du bénéficiaire
Encourager la pratique du don en milieu professionnel
Le recours au don de congés renforce les dynamiques collectives. Pour les employeurs, le dispositif présente plusieurs avantages.
Il permet d’éviter la perte de jours non pris, en particulier ceux placés sur un Compte Épargne Temps, tout en consolidant l’entraide et la cohésion au sein des équipes.
Il offre également un appui concret aux salariés aidants et reflète une culture d’entreprise axée sur le soutien humain.