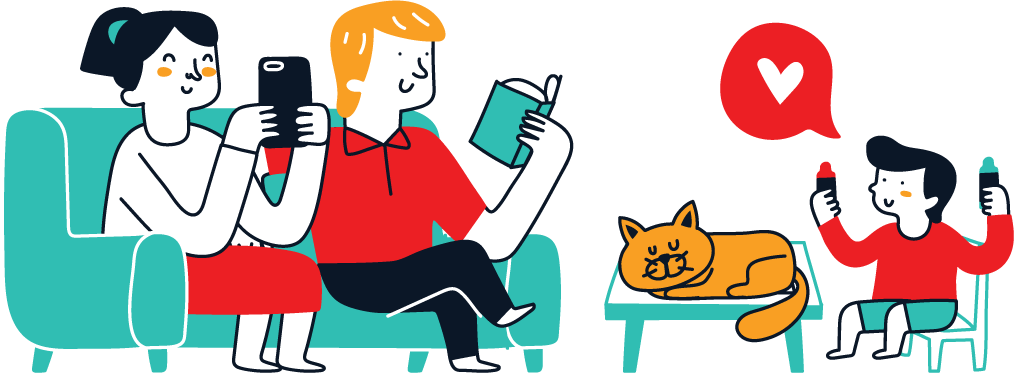En France, tout salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. Cette règle, ancrée dans le Code du travail, s’applique dès l’entrée dans l’entreprise. Mais pour un nouvel embauché, la question demeure sensible : peut-on réellement poser des congés sans attendre la fin d’une première année complète ? Entre dispositions légales, évolutions apportées par la loi Travail – dite El Khomri – et marge de manœuvre laissée aux employeurs, les modalités d’accès aux congés payés dès la première année méritent un examen attentif. Alors, avez-vous droit aux congés payés dès la 1ère année ?
À lire absolument :
- Congés payés et arrêt maladie : une bonne surprise vous attend
- Congés payés non pris : comment vous les faire payer? Les règles à connaitre
- Allez-vous vraiment jeter vos jours de congés payés à la poubelle ?
Une évolution introduite par la loi El Khomri
Jusqu’en 2016, les congés ne pouvaient être pris qu’après la clôture d’une période dite de référence, qui s’étendait du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Cette mécanique avait pour effet de retarder considérablement le repos d’un salarié fraîchement arrivé. Un recrutement en juin signifiait parfois douze mois sans possibilité de congés payés, une contrainte particulièrement lourde pour les salariés en début de carrière.
La réforme portée par la loi Travail, promulguée en août 2016, a modifié cette logique. Elle a instauré la possibilité d’utiliser les congés dès l’embauche, sans attendre la fin de la période d’acquisition. Le Code du travail précise désormais que l’acquisition est mensuelle et que l’utilisation peut intervenir immédiatement, sous réserve des règles internes fixées par accords collectifs ou par l’employeur.
Afin de mieux comprendre ce mécanisme, voici un tableau illustrant l’acquisition des jours de congés au fil des mois :
| Mois d’ancienneté | Jours acquis (2,5 par mois) | Exemple d’utilisation possible |
|---|---|---|
| 1 mois | 2,5 jours | Poser 2 jours de repos |
| 3 mois | 7,5 jours | Une semaine en octobre |
| 6 mois | 15 jours | Trois semaines en hiver |
| 12 mois | 30 jours | Droit complet annuel |
Ce système favorise une gestion plus souple des absences et permet aux salariés de planifier leurs congés en cohérence avec leur vie personnelle, dès leur arrivée dans l’entreprise.
L’employeur conserve la décision finale
Le droit d’acquérir des congés ne signifie pas automatiquement le droit de les poser librement. L’entreprise reste décisionnaire sur l’organisation des départs. Concrètement, cela implique que l’employeur peut refuser une demande, à condition que ce refus soit justifié.
Les motifs les plus fréquents sont :
- La nécessité d’assurer la continuité du service
- Une période de surcharge d’activité incompatible avec l’absence du salarié
- Le respect de l’ordre des départs déjà établi, notamment en période estivale
Ainsi, un salarié embauché en juillet peut parfaitement solliciter une semaine de repos en octobre, dès lors qu’il a cumulé suffisamment de jours. Mais si l’activité atteint un pic à ce moment-là, l’entreprise pourra imposer un report. Le site Service-Public précise que le refus ne doit pas être abusif et doit toujours être motivé par les impératifs de fonctionnement.
D’autres dispositions légales encadrent également la gestion des congés, comme la possibilité de reporter ses jours de congés quand on tombe malade pendant ses vacances.
En définitive, si la loi ouvre l’accès aux congés dès le premier mois d’ancienneté, leur prise reste encadrée par la gestion collective des absences. Le salarié dispose du droit, mais l’employeur en organise l’exercice.

Je m’intéresse aux questions économiques, à la vie des entreprises et aux enjeux liés à la retraite. À travers mes articles, je décrypte l’actualité du monde du travail et du patrimoine, avec l’objectif d’apporter des informations claires, pratiques et utiles à celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre les évolutions du système économique et leurs impacts sur leur quotidien.